BICAMÉRISME À LA FRANÇAISE ET SÉNAT
Thèmes: Civilisation, Histoire, Société COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE DU 13 MAI 2025
BICAMÉRISME À LA FRANÇAISE ET SÉNAT

Par Monsieur Jacques GAUTIER, ancien Sénateur, Vice-Président de la Commission des Affaires Étrangères de la Défense Nationale et des Forces Armées.
INTRODUCTION
De nos jours, de nombreux pays ont un système politique bicaméral comme les Etats-Unis, l’Allemagne ou la Grande-Bretagne et bien sûr la France. Sous des formes diversifiées le bicamérisme se compose d’une assemblée nationale et d’un Sénat, sénat qui existait déjà dans la Rome Antique et qui peut être considéré comme le grand précurseur des Hautes assemblées. Le bicamérisme permet de parvenir à faire de meilleures lois.
I Le Sénat romain.
On date la création du Sénat en 753 avant notre ère et bien qu’il connût certaines évolutions, il restera en place près de 1200 ans aussi bien sous la Royauté que sous la République puis l’Empire et même après la chute de l’Empire d’Occident en 476. Le Sénat a su s’adapter à la gouvernance des Barbares en se contentant d’une représentation municipale et non plus étatique et a donc continué à exister durant un siècle de plus que l’Empire lui-même.
Le sénat romain représente la classe supérieure des citoyens romains, les patriciens jouent donc un rôle important dans le fonctionnement du pouvoir romain. Sous la Royauté le sénat surveillait le roi et jouissait de responsabilités importantes. Suite à la création par Servius Tullius (6em roi de Rome) des comices centuriates élues par les citoyens romains, le sénat perd une partie de ses pouvoirs au profit de cette véritable chambre basse qui nomme les magistrats et les consuls. Ces comices disparaîtront à la fin du premier siècle de notre ère.
A sa création en 753 av. J-C., le sénat comptait 100 membres qui deviendront 300 par la volonté de Tarquin l’Ancien. La fonction de consul étant totalement bénévole seuls les hommes fortunés pouvaient accéder à cette fonction, par conséquent les consuls sont presque toujours des patriciens.
Suite à la disparition des assemblées du peuple – les comices- , le Sénat devient plus puissant et nommera aussi les grands chefs militaires. C’est ainsi qu’il nommera Jules César « dictateur » à vie (dictateur et non empereur) provoquant le mécontentement d’une partie du Sénat qui craignait le retour à la Royauté. Cela amènera à l’assassinat de César en mars 44 av. J-C. Dix-sept ans plus tard, et après une période de guerre civile, et après avoir battu Marc Antoine et Cléopâtre lors de la bataille navale d’Actium en 31 av JC, Octave rétablit la paix et le Sénat lui accorde alors le nom « d’Auguste » et de nouveaux pouvoirs. En 284, l’Empereur Dioclétien réduit les pouvoirs du Sénat mais ce dernier se maintient un siècle après la chute de l’Empire.
II Le bicamérisme.
Le bicamérisme est un système d’organisation politique qui divise le parlement en deux chambres distinctes : une chambre haute (le Sénat) et une chambre basse constituée par les députés.
Il existe divers types de bicamérismes : celui des états fédéraux comme les Etats-Unis ou l’Allemagne, celui qui distingue une classe sociale comme en Grande-Bretagne ou ceux représentant la même réalité nationale mais avec des modalités d’élection et de fonctionnement différentes comme c’est le cas de la France.
Dans le bicamérisme des Etats fédéraux chaque chambre représente les deux éléments constitutifs de l’Etat fédéral à savoir le peuple et les Etats fédérés. C’est le Congrès de la Constitution américaine de 1788 qui a conçu le modèle historique et fondateur du bicamérisme fédéral.
Certains Etats ont choisi de représenter les intérêts d’un groupe social ou ethnique. Le Royaume-Uni fait figure d’exemple de ce type de bicamérisme avec un Parlement constitué par la chambre des Lords, avec des membres nommés ou héréditaires et la chambre des Communes avec des députés élus.
Dans le cas d’Etats unitaires et égalitaires comme la France, une seule chambre pourrait donc suffire. Le choix du bicamérisme est dû à la volonté d’établir un système utile et efficace qui permette de mieux représenter la nation et ainsi de faire de meilleures lois. Le bicamérisme permet à la chambre haute de jouer tantôt un rôle d’impulsion tantôt un rôle de modération.
Les modes électoraux modernes des chambres basses étant très politiques, le Sénat permet d’avoir des points de vue et des amendements moins marqués par une logique partisane et donc bien plus techniques et pertinents. Ainsi en France 72% des amendements votés par le Sénat restent dans la loi même lorsque le dernier mot revient à l’Assemblée Nationale.
Il existe différents types de scrutin pour nommer les sénateurs : élections au suffrage universel, proportionnelles, mixtes, majoritaires, nomination totale ou partielle. En France, les sénateurs sont élus par département par un collège électoral constitué d’élus locaux, provinciaux ou nationaux avec des mandats de 6 ans et un renouvellement partiel par moitié. Ce système donne au Sénat une stabilité et une continuité certaine ce qui permet un travail efficace.
De façon générale, le bicamérisme a une double fonction, celle d’effectuer un travail législatif mais aussi de contrôler le Gouvernement garantissant ainsi une réelle démocratie.
III Histoire du Sénat en France.
En France, le Sénat est né en 1795 avec la Constitution thermidorienne sous le nom de Conseil des Anciens mais il disparaît quatre ans plus tard. Napoléon Bonaparte fasciné par l’Empire romain recrée le sénat dit Conservateur qui comprend 100 membres (comme le premier sénat romain) et qui siège au Palais du Luxembourg. Cette chambre haute bénéficie d’honneurs et de fastes mais finira par s’opposer à l’Empereur.
Sous la Restauration (1814-1830), l’évolution vers un régime parlementaire « à l’anglaise » fait de la chambre des Pairs une réplique de la chambre des Lords mais Louis XVIII puis Charles X vont devoir compter avec ces parlementaires de toutes opinions qui ont pris goût à la liberté de parole.
Avec Louis Philippe et la Monarchie de juillet (1830-1848), la chambre des Pairs s’embourgeoise reflétant l’évolution de la société. Les notables entrent à la chambre haute et les thèmes économiques sont largement débattus. Sous le Second Empire (1851-1870), le Sénat retrouve l’esprit du Sénat Conservateur du Consulat et du Premier Empire dans un régime autoritaire qui tente d’étouffer toutes les manifestations de la démocratie parlementaire.
En 1875 sont promulguées les Lois Constitutionnelles qui instituent un Sénat républicain. Sous la IIIe République (1875-1940) les deux chambres vont jouer un rôle essentiel.
Après la seconde guerre mondiale, la Constitution de 1946 réduit le rôle du Sénat qu’elle baptise Conseil de la République mais peu à peu la chambre haute va retrouver son rôle stabilisateur et une partie de son influence.
Avec l’instauration de la cinquième République en 1958, le Sénat retrouve sa place dans les institutions et contribue efficacement à leur équilibre.
Depuis l’installation du Sénat Conservateur en 1799, le Palais du Luxembourg a gardé sa vocation parlementaire excepté durant quelques courtes périodes comme en 1940 lorsqu’il est occupé par l’État-major de la Luftwaffe.
IV Le Sénat actuel.
Pour assurer la stabilité des institutions, la Constitution de la Ve République a voulu que le Sénat ne puisse renverser le Gouvernement au contraire de l’Assemblée Nationale mais contrairement à cette dernière, il ne peut être dissout. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la France et son Président – le deuxième personnage de l’Etat – assure l’intérim du Président de la République en cas de vacance ou d’empêchement.
Les sénateurs sont élus au suffrage indirect pour 6 ans (9 ans avant 2004) dans les départements, les collectivités Outre-Mer et par les Français de l’étranger (9 sénateurs). Le corps électoral comprend les élus municipaux, départementaux, régionaux, nationaux et européens ; le vote est obligatoire.
Actuellement le Sénat comprend 348 sénateurs dont deux tiers sont des hommes mais l’on tend à arriver à la parité. 25% des sénateurs sont des salariés, 20% exercent des professions libérales, 13% sont des fonctionnaires (hors EN), 9.8% n’ont pas de profession déclarée et 9.5% sont des enseignants. Le nombre de sénateurs à élire dans un département dépend de l’importance démographique de sa population. Ainsi il n’y a qu’un sénateur pour la Lozère mais 11 pour le Nord. L’âge minimum pour se présenter est de 24 ans. L’âge moyen du Sénat est de 59 ans soit 10 ans de plus que la moyenne de l’Assemblée Nationale. Tous les sénateurs sont des élus expérimentés, reconnus par leurs pairs et ayant effectué un travail local efficace.
Lorsqu’il est élu, un sénateur prend ses fonctions et doit s’inscrire dans un groupe politique ou siéger en indépendant ; ensuite chaque sénateur s’inscrit dans une commission spécifique : culture, Armée, économie etc. ; il peut aussi s’inscrire dans une commission transversale comme celle des Affaires Européennes.
Un projet de loi est envoyé en première lecture soit à l’Assemblée nationale soit au Sénat. Quand un projet de loi arrive au Sénat, il est envoyé à la Commission compétente dans le domaine concerné. La Commission nomme un ou deux rapporteurs et travaille aussi bien en lien avec le Ministre concerné qu’avec des industriels ou tout expert extérieur susceptible d’aider au travail de la Commission. Cette dernière précise, corrige et apporte les amendements nécessaires afin que la loi soit le plus efficace possible. A la fin de l’examen d’un texte en première lecture, à l’Assemblé nationale ou au Sénat, le projet de loi est examiné par l’autre Chambre, c’est la Navette parlementaire. Lorsqu’un texte de loi ne fait pas consensus, on crée une Commission mixte paritaire composée de 7 sénateurs et 7 députés. En cas de désaccord, et après une seconde lecture dans les deux Chambres, l’Assemblée Nationale a le dernier mot.
Le Sénat rédige également des rapports sur des thèmes d’actualité de l’Etat et non uniquement des projets de loi.
On constate parfois que l’hémicycle est presque vide. Cela s’explique par le fait que tous les sénateurs ne sont pas compétents dans tous les sujets, dans ce cas leur présence n’est pas indispensable. Par ailleurs, de nombreux sénateurs sont loin de Paris et ne peuvent pas se déplacer systématiquement en dehors des séances plénières.
Les députés perçoivent un salaire qui depuis 1992 est soumis à l’impôt et ont droit à des frais de représentation qu’ils doivent justifier.
Au Sénat, les Commissions ont plus de poids que les partis politiques contrairement à l’Assemblée Nationale où les députés ont une vision plus partisane.
CONCLUSION
Le Sénat a une longue histoire et ce depuis l’Antiquité. De nos jours le Sénat joue un rôle essentiel dans le bicamérisme, système garant de la démocratie.
Sans aucun doute le Sénat travaille pour le bien et l’intérêt de l’Etat et de la France en travaillant toujours dans une optique plus technique que politique.
+ de 1100 textes des conférences du CDI sont disponibles sur le site du CDI de Garches et via le QRCode
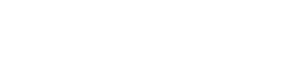


Un commentaire
Jean-Michel BUCHOUD
Jun 08, 2025
Une belle leçon d'instruction civique. Merci Monsieur le Sénateur