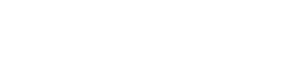POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE D’ABANDONNER LE POUVOIR ?
Thèmes: Art, Histoire, Géopolitique, Société Conférence du mardi 28 avril 2025
POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE D’ABANDONNER LE POUVOIR ?
POURQUOI D’AUTRES, COMME CHARLES QUINT, Y RENONCENT-ILS PLUS FACILEMENT ?
par Madame Isabelle de MONTGOLFIER, agrégée en langue et littérature espagnoles, professeur en classes préparatoires et en faculté, conférencière,
et par Monsieur Pierre ANGOTTI, auteur de plusieurs ouvrages de développement humain.

INTRODUCTION
Chaque personne porte en elle le bien et le mal. Écouter son désir profond exige beaucoup de courage car on est pris par les conventions, les attentes des autres, l’héritage familial, etc. Par ailleurs, le pouvoir donne un confort certain et engendre une satisfaction dont il est parfois difficile de se passer. Le pouvoir est une sorte d’adrénaline d’où la difficulté de l’abandonner. Cependant, parfois on se sent dépassé et usé, dans ce cas il faut renoncer, ce fut le cas de Charles Quint.
I. De la difficulté de renoncer au pouvoir.
De nombreuses personnes n’ont pas su renoncer au pouvoir au cours de l’histoire, on peut citer Ben Ali qui est resté 23 ans au pouvoir en Tunisie, Moubarak en Egypte, 29 ans à la tête de l’Etat, avant d’en être chassés, ou Robert Mugabe, qui a gouverné le Zimbabwe durant 37 ans, avant d’en être « démissionné ».
Le pouvoir satisfait plusieurs besoins de l’être humain : le besoin de reconnaissance, de se sentir différent, d’exercer une autorité sur les autres et de servir l’intérêt général. Ces besoins sont légitimes mais poussés à l’excès ils sont néfastes.
Le pouvoir engendre de la satisfaction et donc un bien-être positif pour la santé. Hormis cette sensation de plaisir, les raisons pour rester au pouvoir sont diverses : possibilité de s’enrichir, pression de l’entourage, moyen d’échapper à la justice, conviction d’être la seule personne compétente.
Le pouvoir modifie l’esprit et les comportements de la personne au pouvoir. En effet, le cerveau utilise divers réseaux cérébraux. Normalement, le cortex pré-frontal contrôle le striatum qui est l’organe à l’origine de nos désirs. Une fois satisfait, la dopamine, qui est l’hormone du plaisir, se répand dans notre cerveau. Or le pouvoir peut altérer cet équilibre. Les personnes dans ce cas perdent tout sentiment d’empathie et deviennent impulsives. Pourtant certains hommes de pouvoir ont pu renoncer au pouvoir comme le Consul romain Cincinnatus (519 – 430 av. J-C), le roi wisigoth Wamba 633-688) qui refusa le pouvoir, ou Richard II d’Angleterre qui abdiqua en 1399 en faveur de son cousin Henri (le futur Henri IV) ou l’Empereur Charles Quint au XVIe siècle.
II L’abdication de Charles Quint.
Dans son discours au Palais de Coudenberg à Bruxelles, le 25 octobre 1555, l’Empereur Charles Quint évoque trois raisons majeures à son abdication : sa maladie, sa lassitude d’avoir tant combattu et sa tristesse.
L’Empereur s’était déjà retiré deux mois, au couvent de la Sysla, à la suite de la mort de son épouse Isabelle, puis dans les années 1540, il commence à transférer à son fils Philippe (futur Philippe II) certaines de ses possessions. Charles Quint est un homme fragilisé par la goutte et le diabète aussi a-t-il du mal à se mouvoir. En 1555, il prend donc la décision de se retirer définitivement au monastère de Yuste en Estrémadure. Il prend le chemin de retour en Espagne en débarquant à Laredo en Cantabrie, puis en poursuivant jusqu’à Yuste, où il réside dans le monastère de l’Ordre de Saint Jérôme, de 1556 à 1558, date de sa mort, passant une vie de réflexion et de retrait. Deux tableaux du Titien peints à un an d’intervalle montrent deux facettes bien distinctes de l’Empereur. D’une part Portrait équestre de Charles Quint à Mühlberg (1547) où Charles Quint apparaît en conquérant sur son cheval, mais seul, car le pouvoir s’exerce seul et d’autre part Portrait de Charles V (1548) où l’Empereur apparait assis, tout de noir vêtu, ne portant pour tout apparat que la toison d’or, et avec une canne près de son fauteuil. C’est le portrait de vieillesse.

Un des plus grands regrets de Charles Quint, le très catholique, est de ne pas avoir pu rétablir l’unité catholique face aux princes protestants allemands. N’avait-il pas écrit en recevant la couronne de roi des Romains des mains des archevêques de Cologne, de Mayence et de Trèves en 1520, « Je promets devant Dieu et ses anges de conserver maintenant et à l’avenir la paix dans la Sainte Église ». Cette unité lui tenait tant à cœur qu’il se refuse de signer le traité d’Augsbourg en septembre 1555. C’est son frère, Ferdinand, qui le signera, instaurant ainsi officiellement le protestantisme dans certaines régions européennes.
Fortement influencé par Erasme et la Complainte de la Paix publiée en 1516 Charles Quint désirait être un homme de paix. Citons quelques paix signées durant son règne, comme la Paix des Dames en 1529 entre Charles Quint et François 1er négociée et signée par Marguerite d’Autriche pour l’un et Louise de Savoie pour l’autre, ou la Paix de Barcelone avec le pape Clément VII, ou encore la Paix de Nice avec François 1er en 1537, ou encore le Traité de Crépy-en-Laonnois par lequel Charles Quint lâche la Bourgogne. Recherchant inlassablement la paix, mais faisant la guerre, presque à regret pourrait-on dire, Charles Quint avait ainsi recommandé à son fils Philippe en 1548 « Maintenez la paix, éviter la guerre. Faites tout ce qui est possible pour maintenir la paix ».

III L’homme derrière l’Empereur
Charles Quint, alors Charles de Gand, n’a que 19 ans lorsqu’il apprend la mort de son grand-père Maximilien Ier, Empereur du Saint-Empire germanique. C’est un jeune homme fragile, qui s’évanouit durant deux heures, dans la cathédrale de Saragosse, à l’annonce de ce décès. On croit qu’il est mort. Était-ce l’expression d’un corps refusant de vivre une vie autre que celle à laquelle il aspirait réellement ? Très vite, Charles se rend compte de l’ampleur de la tâche qui lui incombe, et sa personnalité, empreinte de sensibilité et d’inquiétude, semble être un handicap pour exercer le pouvoir d’un empire aussi vaste. Sur sa tête vont peser pas moins de 17 couronnes. Il doit essentiellement gérer son héritage ne conquérant lui-même que le duché de Milan et quelques territoires néerlandais dont le comté d’Artois, et la province d’Utrecht.
Sa personnalité est marquée par ce que l’on nomme le retrait. Cela est probablement dû au fait qu’il a perdu son père très jeune et qu’il voit très peu sa mère, Jeanne de Castille dite Jeanne la folle, celle-ci souffrant de troubles psychologiques. C’est quelqu’un de mélancolique qui aime la vie de famille mais ses obligations de souverain notamment ses nombreux déplacements l’empêchent d’en profiter. Ainsi, ne vivra-t-il réellement que six ans avec son épouse Isabelle, qu’il chérissait particulièrement.
Sa vie est pleine de contradictions. Ainsi il prêche la paix, mais fait régulièrement la guerre à son rival François Ier et à Soliman, tout comme aux princes germaniques devenus protestants au sein même de son empire. Il est très pieux, mais sous son règne, aura lieu le sac de Rome et l’emprisonnement du Pape en 1527.
C’est un homme de réflexion plutôt que d’action, il voulait être un berger mais agissait en lion pour épouvanter les loups, plus par la force des choses que par conviction, pour se défendre contre l’ambition désordonnée de ses ennemis.
Charles Quint abandonne le pouvoir pour être en paix avec lui-même. Il a vu dans l’abdication le moyen de mettre fin à un déchirement intérieur, l’écartèlement entre ce que l’homme voulait vivre et ce que l’homme d’Etat devait accomplir. A la fin de sa vie, il se détache des biens matériels suivant ainsi la règle de Saint Jérôme (pénitence et ascétisme) et refuse d’être appelé par son titre d’Empereur lors de sa retraite au monastère de Yuste. Lorsque son frère Ferdinand est élu empereur d’Allemagne le 12 mars 1558, aussitôt Charles Quint commande de nouveaux sceaux « sans couronne, sans aigle, sans toison ».



Oser retirer mon armure qui me protégeait de la tête aux pieds et devenir vulnérable. Tant que je me suis senti l’héritier de lignes prestigieuses, tant que j’étais dans une démarche de pouvoir, j’étais dépossédé de mon moi profond
CONCLUSION
Charles Quint a su, contrairement à beaucoup de gouvernants, résister aux 3 problématiques de la condition humaine: résisterà la tentation consistant à s’attacher au pouvoir et à celles de l’avoir (il possédait tout, il renonce à tout) et du valoir (« Maintenant que je suis rien, le prénom de Charles me suffit » dira-t-il à ses compagnons à Yuste.
Charles Quint est un modèle de renoncement à la tentation de l’avoir, même si Thucydide écrivait que
« La nature humaine est incapable de résister aux entrainements des passions ».
Montaigne voyait en Charles Quint un bel exemple du triomphe de la raison en écrivant « La plus belle des actions de l’empereur Charles cinquième fut d’avoir su reconnaître que la raison nous commande de nous dépouiller quand nos robes nous chargent…Lorsqu’il sentit défaillir en lui la fermeté et la force pour conduire les affaires. » (Essais, II, 8).
Daniel Rops, de l’Académie française dit de lui : « Un tel homme est grand dans le geste même qu’il accomplit : ayant tout possédé, ayant tout renoncé, l’homme le plus puissant de la terre a surmonté la puissance ; il a quitté ses biens et prit sa croix ».
Retenons quelques personnalités qui ont su abandonner volontairement le pouvoir ou ne plus le briguer : Léopold Sédar-Senghor au Sénégal en 1980, le Camerounais Ahmadou Ahidjo en 1982, Julius Nyerere en Tanzanie en 1985, le Sud-Africain Nelson Mandela en 1999, Lee Hsien Loong à Singapour en 2024, le Grand-Duc de Luxembourg qui se retire confiant en la capacité de son fils, le prince Guillaume, à lui succéder.
Des souverains ont su laisser le pouvoir comme Marguerite II du Danemark ou la reine Beatrix des Pays-Bas au contraire d’Elizabeth II qui régna 70 ans et qui n’évoqua une éventuelle abdication qu’à la toute fin de sa vie mais qui resta au pouvoir jusqu’à sa mort. Voulut-elle régner plus longtemps que Louis XIV ?
N’oublions pas la démission du pape Benoit XVI, deuxième pape de l’histoire de l’Église à avoir démissionné.
L’abandonner ou ne pas le briguer, dans un geste démocratique, comme Charles de Gaulle, Michel Rocard, Jean-Pierre Chevènement, Jacques Delors. Paul Ricoeur écrivait dans La mémoire, l’histoire et l’oubli : « Le politique est parfois un lieu où des “gestes” sont possibles dont la portée est autre que la simple lutte “machiavélienne” pour le pouvoir ».
« L’être au cours de la vie, au cours de son existence doit apprendre à mourir. Et ces occasions nous sont données si souvent ; toutes les crises, les séparations, et les maladies, et toutes les formes, tout, tout, tout, tout nous invite à apprendre et
à laisser derrière nous. La mort ne nous enlèvera que ce que nous avons voulu posséder. Le reste, elle n’a pas de prise sur le reste. Et c’est dans ce dépouillement progressif que se crée une liberté immense, et un espace agrandi, exactement ce qu’on n’avait pas soupçonné. Moi j’ai une confiance immense dans le vieillissement, parce que je dois à cette acceptation de vieillir une ouverture qui est insoupçonnable quand on n’a pas l’audace d’y rentrer. »
Christiane Singer Derniers fragments d’un long voyage
Bibliographie :
Isabelle de Montgolfier et Pierre Angotti, Charles Quint, entre grandeur et humilité. Éditions Médiaspaul, Paris, 2022. Prix Littré du roman historique 2023 et Premier prix de la Cité Littéraire de Nevers 2024.